Comment les sciences évoluent-elles ?
Médiation scientifique ● Méthodologies ● Épistémologie
#histoire des sciences #outreach #vulgarisation
Édition, 16 p.
Léonie Lefere
Étudiante en master Communication visuelle et graphique
@leoniedoesviscom
www.leonielefere.be
Félix Devaux
Docteur, expert valorisation et médiateur scientifique Laboratoire de Chimie des Polymères (LCP), Faculté des Sciences, ULB

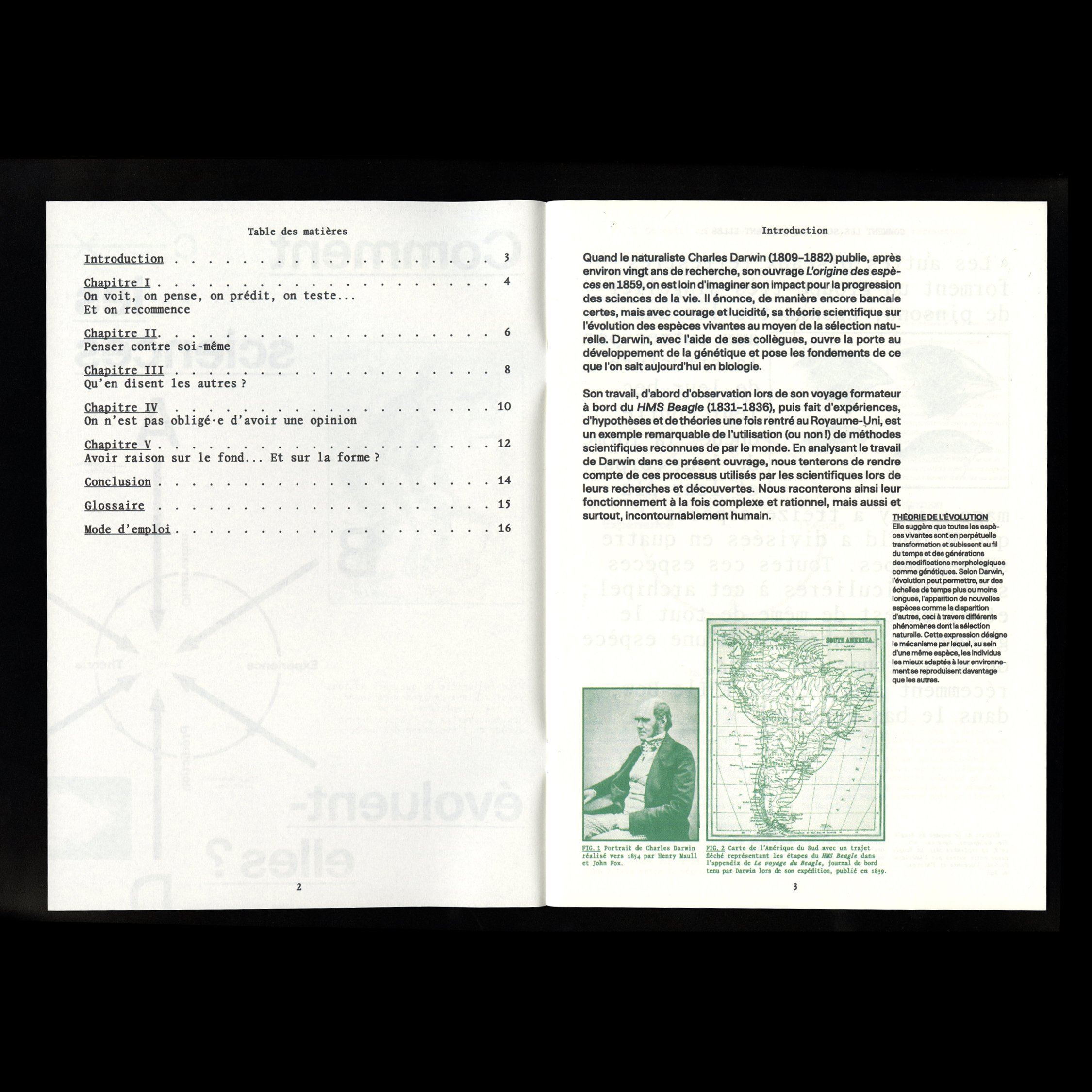





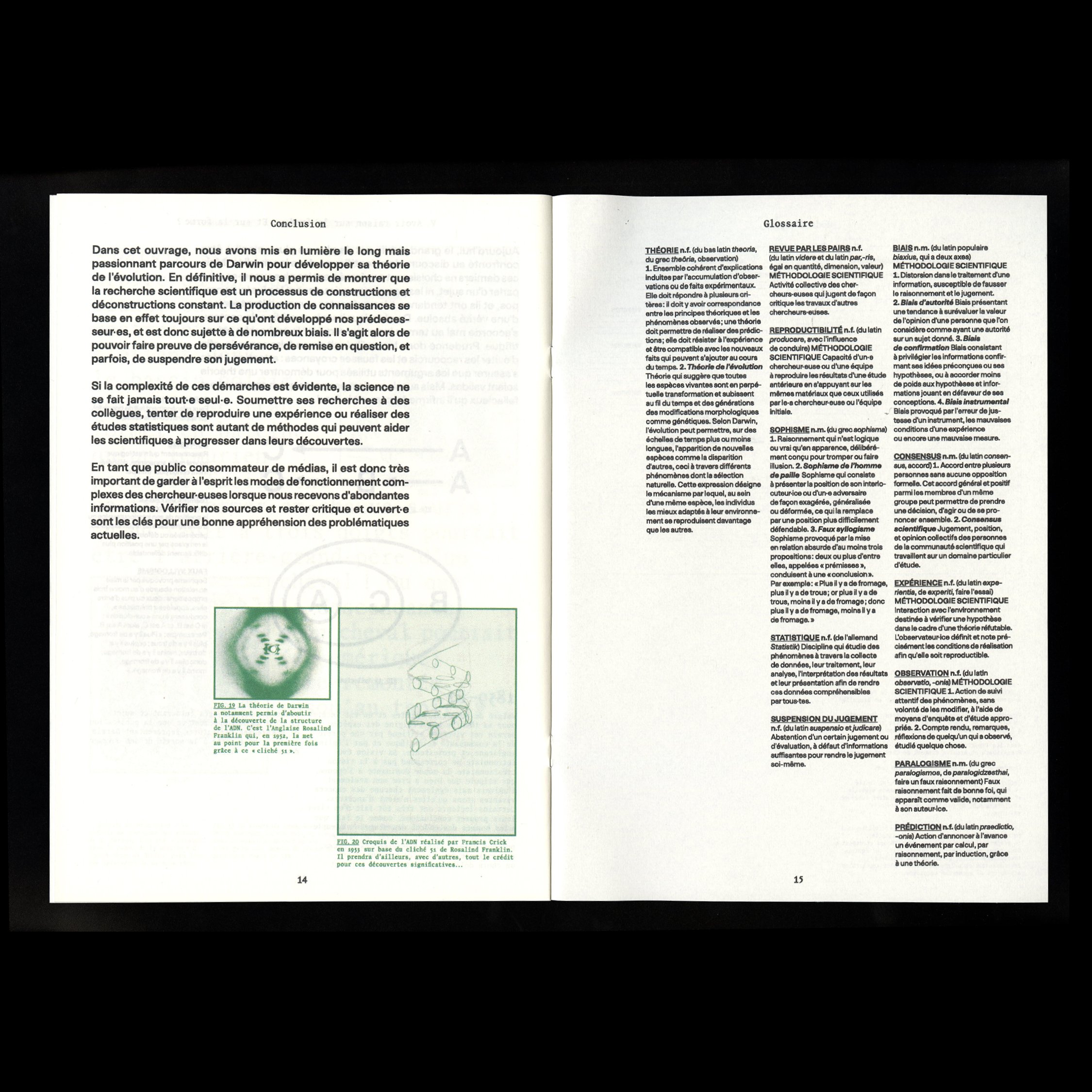

« J’ai beaucoup aimé en apprendre plus sur la façon dont les scientifiques procèdent lorsqu’ils et elles font leurs recherches, pouvoir en discuter avec quelqu’un dont c’est le domaine, ainsi que réussir à faire du traitement graphique de l’information par le texte et l’archive, ce qui a été un chouette challenge. »
Transmission et communication autour des méthodes scientifiques
Les processus, méthodes et biais dans la recherche académique et le développement de nouvelles connaissances scientifiques
La représentation populaire présente les chercheurs et les chercheuses comme des êtres fonctionnant à la raison, qui n’avancent que sur base de preuves étayées. Les méthodes de recherche et leurs logiques sous- jacentes sont cependant mal connues du grand public. La production de connaissances scientifiques est un processus itératif complexe, nécessitant de multiples vérifications et un réajustement constant.
Il existe en effet de nombreuses possibilités pour que des conclusions scientifiques perdent en fiabilité. Du point de vue des chercheur·euse·s, certains biais cognitifs peuvent influencer leur résultat : biais de confirmation (s’arrêter aux résultats qui correspondent à ce qu’il ou elle attend), biais d’autorité (suivre sans recul critique l’avis d’une personne expérimentée), croyances préexistantes, etc. Les instruments de mesure employés et les méthodes d’analyse peuvent également mener à des résultats discutables. On parle alors de biais instrumentaux. Enfin, le contexte de recherche entre également en jeu dans la production des résultats : fatigue, pression, délais, etc.
Afin de pallier ces écueils, les sciences ont développé au fur et à mesure de nombreux outils de vérification : la reproductibilité, la revue par les pairs, des outils statistiques, etc. L’épistémologie, une discipline scientifique, s’attache même à étudier les méthodes de production des connaissances.
L’humain est également capable de métacognition, processus mental, qui permet d’analyser ses propres mécanismes de pensées. L’ensemble de ces moyens vise, à défaut de corriger toutes les erreurs, à les limiter fortement. Cependant, ils sont aussi intrinsèquement chronophages. S’il est capital pour les chercheur·euse·s de connaître ces techniques, il m’apparaît également important que le grand public en ait connaissance. Cela leur permet notamment d’être critiques envers les informations qui leur sont présentées. La pandémie de COVID-19 a été un exemple frappant des conséquences que peuvent avoir une mauvaise communication des recherches scientifiques, notamment par le traitement médiatique. En effet, la recherche nécessite du temps pour tirer des conclusions solides, mais le fonctionnement actuel des médias requiert de quoi alimenter leurs nouvelles quotidiennes. Par effet pervers, les expert·e·s les plus enclins à modérer leurs propos, faute de preuves, n’étaient pas celles et ceux qu’on invitait à s’exprimer. Cela a mené à de nombreux messages contradictoires et a contribué à retarder la mise enplace de mesures efficaces.
De même, le besoin médiatique en expert·e·s a mené à interroger les plus disponibles hors de leur domaine de compétence, tout en les présentant comme spécialistes. À partir de ces différents points, ce projet s’attache donc à présenter les bases des méthodologies scientifiques par des repères simples, pour le public non-scientifique. L’idée est donc de transmettre au grand public les éléments à prendre en compte quand il est confronté à des résultats de recherche.
